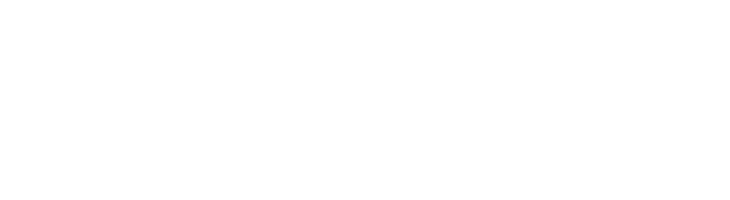Activer le mode zen
Ressource au format PDF
Mots-clés
Classification
L'acoustique au service des distilleries d'alcool
03/11/2025
Table des matières
Introduction
Certaines distilleries au Brésil utilisent une technique étonnante pour savoir si un alcool est de bonne qualité. Après une courte agitation de la bouteille qu'ils souhaitent tester, ils frappent la bouteille avec un couteau en métal et écoutent le son émis par l'ensemble. Ils peuvent ensuite conclure sur la qualité de l'alcool contenu dans la bouteille. Voici une vidéo présentant cette méthode de vérification des alcools :
|
Source : Diguinho498 |
Nous observons après l'agitation de la bouteille trois phénomènes principaux que nous allons caractériser et tenter d'expliquer dans la suite : une diminution de l'intensité sonore, un changement de la fréquence du son émis et un son plus mat (c'est-à-dire plus étouffé). Visuellement, nous observons aussi l'apparition de bulles d'air dans le liquide.
Remarque :
La deuxième question sur les alcools gazeux n'a pas eu le temps d'être traitée dans le détail et ne sera donc pas traitée dans cet article.
1. Protocole expérimental
Afin de faire des mesures quantitatives sur le phénomène décrit en introduction, nous devons rendre le plus reproductible possible la manipulation réalisée dans la vidéo. Plusieurs choix de paramètres interviennent dans l'expérience : la bouteille, le liquide à l'intérieur, l'agitation de la bouteille et la façon dont on tape sur celle-ci. Pour la bouteille, nous utiliserons toujours la même : une bouteille en verre de 500 mL (cf. figure 1). Le liquide sera le paramètre que nous modifierons afin de comprendre l'origine du phénomène (cf. parties 4 et 5).
Pour l'agitation, nous n'avons pas réussi à mettre en place un protocole simple et reproductible. Ainsi, nous avons agité la bouteille « à la main et fortement » pendant une durée fixe (autour de 5 secondes), en espérant que l'on soit au-delà d'une agitation seuil ; de sorte que des variations d'agitation induisent de faibles variations dans les résultats observés. Finalement, nous avons utilisé un pot vibrant, avec une bille métallique collée à son bout, alimenté avec un signal créneau asymétrique pour frapper sur la bouteille. La bouteille est maintenue à l'aide de deux cales en plastique collées sur le support, de sorte que la localisation de l'impact et la distance entre la bille et le pot vibrant soient identiques entre les expériences, comme montré sur la photo, figure 1.
|
Figure 1. Photo du dispositif expérimental Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
L'acquisition du signal sonore a été réalisée avec un iPhone 8 placé à proximité de la zone d'impact de la bille sur le verre. La figure 2 montre un exemple du signal acquis lors d'une expérience : c'est un signal périodique (car nous frappons sur la bouteille de façon périodique), et le son de chaque choc est une sinusoïde d'amplitude décroissante. Le choix de la période des chocs est fait de sorte que le système (bouteille + liquide + air) cesse de vibrer avant le choc suivant : nous avons donc pris une fréquence de 1 Hz pour alimenter le pot vibrant. Le fichier audio donné au-dessous de la figure 2 correspond à l'enregistrement de cette expérience avec du Campari.
|
Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
2. Modélisation du système que nous faisons résonner
La première question à laquelle nous avons souhaité répondre était : « qu'entendons-nous lorsque nous frappons sur cette bouteille en verre ? ». Nous avons trois systèmes qui peuvent être siège d'une résonance : la bouteille en verre (avec des modes transverses ou des modes longitudinaux), le liquide et l'air. Puisqu'une étude détaillée et analytique de ce système serait trop compliquée et peu utile pour ce que nous voulons faire, nous allons faire un raisonnement qualitatif pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Lorsque nous excitons le système avec le pot vibrant, la bouteille de verre vibre (modes transverses uniquement) et se couple aux deux autres résonateurs (« liquide » et « air ») qui vont modifier ses caractéristiques de résonance, comme schématisé sur la figure 3.
|
Figure 3. Schématisation du modèle utilisé pour décrire notre système Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
La première expérience que nous avons réalisée est donc la suivante : afin d'observer l'influence des résonateurs « liquide » et « air » sur la façon dont la bouteille en verre vibre, nous analysons la fréquence du fondamental sans aucune agitation préalable et avec différents niveaux de liquide. Le liquide choisi est l'eau pour cette expérience. Ainsi, en réalisant plusieurs acquisitions avec différents niveaux d'eau, on modifie les résonateurs avec lesquels la bouteille se couple et la force de couplage avec ceux-ci (plus il y a d'eau dans la bouteille et plus la force de couplage avec le résonateur « eau » est importante).
Nous présentons les résultats sur la figure 4 : nous observons une modification de la fréquence du fondamental due au changement du volume de remplissage.
Remarque : dans toutes les autres expériences, le niveau de remplissage du liquide sera maintenu constant pour éviter un biais dû à ce paramètre sur nos mesures.
|
Figure 4. Influence du taux de remplissage de la bouteille sur la fréquence du fondamental Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Ces premiers résultats montrent que le son émis par la bouteille lorsque l'on frappe dessus dépend de la façon dont le son se propage à l'intérieur de la bouteille. De cette première expérience nous pouvons faire l'hypothèse suivante : l'agitation de la bouteille modifie les caractéristiques de propagation sonore dans le liquide et change alors le son émis par le système lorsque l'on frappe dessus. C'est cette hypothèse que nous allons essayer de valider dans la suite (cf. partie 5).
3. Étude quantitative du régime transitoire
Nous souhaitons maintenant avoir une mesure quantitative du phénomène. Nous avons observé trois comportements principaux dans cette vidéo : une modification de la fréquence des sons émis, une diminution du volume sonore et un étouffement des sons émis. Nous allons dans cette partie essayer d'observer expérimentalement ces trois comportements.
Commençons par analyser le changement de la fréquence de résonance : pour cela nous enregistrons le signal après l'agitation de la bouteille et nous réalisons une analyse fréquentielle du signal acquis. Pour cette acquisition, nous avons choisi le Campari (liqueur italienne) car c'est la boisson où l'on observait le mieux le phénomène parmi les différentes boissons que nous avons essayées.
L'origine des temps (t = 0 s) est fixée par la fin de l'agitation de la bouteille. Le diagramme temps-fréquence de l'expérience est présenté sur la figure 5. On représente la densité spectrale du signal (en couleur sur la figure) à chaque instant (le temps étant en abscisse). La durée des fenêtres du spectrogramme pour les transformées de Fourier est fixée \( T_{fenetre} = T_{pot~vibrant} =\) 1 s car cela permet d'avoir une précision fréquentielle de 1 Hz et d'avoir la décomposition spectrale de chaque son émis sans recouvrement.
|
Figure 5. Spectrogramme du signal acquis pendant 2 minutes après l'agitation d'une solution de Campari Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Nous observons un régime transitoire, d'une durée d'environ 1 minute, où les fréquences de tous les modes sont décalées vers le grave. Ce régime transitoire est qualitativement défini avant la ligne en pointillés sur la figure 5. Il y a donc deux paramètres que nous pouvons extraire de ce spectrogramme pour chaque mode : la valeur du décalage fréquentiel et le temps caractéristique du retour à l'équilibre.
La figure 6 présente l'évolution de la fréquence du fondamental en fonction du temps (croix bleues) et la modélisation sous forme d'une exponentielle (trait rouge), obtenue par régression. La régression est réalisée avec la fonction suivante :
$$ f(t) = f_0 \big(1 - \beta e^{-\frac{t}{\tau}} \big) $$
où \( f_0 \) est la fréquence à l'équilibre, \( \beta = \frac{\Delta f}{f_0} \) est le décalage en fréquence (normalisé) et finalement \( \tau \) est le temps caractéristique du retour à l'équilibre.
|
Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Les valeurs trouvées pour l'exemple montré sur la figure 6 sont : \( \beta =\) 0,47 et \( \tau =\) 25 s.
On retrouve bien une fin de régime transitoire autour de \(t \approx 3\tau =\) 45 s, comme observé sur la figure 5. Grâce à l'analyse fréquentielle, nous avons donc deux paramètres que nous pouvons extraire pour chaque expérience : \( \beta = \frac{\Delta f}{f_0} \) qui représente l'intensité du décalage fréquentiel vers les graves et \( \tau \) qui indique le temps caractéristique nécessaire pour un retour à l'équilibre.
Intéressons-nous maintenant à la diminution d'intensité sonore : nous calculons l'énergie de chaque son émis à la suite d'un coup porté par la bille métallique. L'expression de cette énergie est :
$$ E_n = \int_{t_n}^{t_n + T} s^2(t) dt $$
Le signal est noté \( s(t) \), \(n\) est le numéro du coup porté à la bouteille à l'instant \(t_n\). La période \(T\) est celle du pot vibrant et vaut 1 seconde (ce qui nous donne \(t_{n+1} = t_n + T\) ).
|
Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Sur la figure 7 (à gauche), nous observons qualitativement que l'intensité du signal du premier choc est plus faible que celui du 100ème (après retour à l'équilibre). De façon plus quantitative, nous traçons sur la partie droite de la figure 7 les énergies de chaque coup.
Comme pour l'analyse fréquentielle, on observe un régime transitoire d'une durée environ égale à 1 minute (comme pour celui de l'étude en fréquence) et à l'issu duquel nous avons un régime stationnaire. Compte-tenu du bruit de mesure sur cette expérience, il semble difficile de reconnaitre différents régimes et d'exploiter quantitativement ces mesures.
Finalement, nous étudions l'étouffement des sons émis, observé sur la vidéo dans l'introduction. Pour ce faire, nous allons extraire le temps de décroissance de l'amplitude du son émis pour chaque coup, comme montré sur la figure 8.
|
Figure 8. Temps de décroissance du son émis à la suite d'un coup sur la bouteille Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Nous traçons l'enveloppe de la fonction suivante : \( g(t) = \ln \big(s^2(t) \big) \), avec \( s(t) \) le signal montré sur la figure 8. La fonction \( g(t) \) ainsi que son enveloppe (extraite à l'aide d'une méthode de traitement de signal non détaillé ici) sont tracées sur la figure 9.
|
Figure 9. À gauche : tracé de la fonction g(t). À droite : tracé de l'enveloppe de g(t) en fonction du temps Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Les parties de la courbe surlignées en rouge (sur la figure 9 de droite) correspondent aux régressions linéaires réalisées sur ces portions de courbes. La pente de ces droites vaut alors :
$$ pente = - \frac{1}{t_{decay}} $$
Où \( t_{decay} \) est le temps de décroissance exponentielle de l'amplitude du signal \( s(t) \). En réalisant ce traitement pour chaque son émis, nous traçons sur la figure 10 la valeur de ce temps de décroissance en amplitude en fonction du temps.
|
Figure 10. Tracé du temps de décroissance de l'amplitude en fonction du temps Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Comme précédemment, nous observons un régime transitoire puis un régime d'équilibre pour les temps longs. Cependant, comme pour l'énergie, la courbe tracée ici sur la figure 10 est assez bruitée. Extraire de cette courbe un temps caractéristique d'évolution ou une variation globale de valeurs entre le début et l'équilibre est donc compliqué.
En conclusion de cette partie, nous avons montré expérimentalement l'existence des trois comportements que nous avons observés qualitativement en introduction : décalage fréquentiel, diminution du volume sonore et étouffement des sons émis. Dans la suite, nous analyserons la présence du phénomène uniquement avec le décalage fréquentiel, et cela pour deux raisons : c'est la méthode la plus précise des trois et elle nous donne deux paramètres permettant de connaître l'intensité (\( \beta \)) et la durée du phénomène (\( \tau \)).
4. Origine de l'atténuation observée
Pour discuter l'origine de l'atténuation, observons ce qu'il se passe lorsque l'on secoue énergiquement la bouteille : on crée un mouvement de convection dans le liquide, mais on crée aussi des bulles d'air dans le liquide qui remontent progressivement à la surface.
Pour étudier l'effet du mouvement de convection du liquide après agitation, nous avons utilisé un agitateur magnétique et un barreau aimanté pour créer un tourbillon dans le liquide mais sans présence de bulles au sein de celui-ci. Alors, nous n'avons pas constaté les phénomènes d'atténuation décrits précédemment. Il en résulte que l'atténuation provient donc de la présence des bulles d'air qui modifient le liquide en un milieu effectif dont les propriétés varient avec le temps.
Nous avons décidé de remplacer les bulles par des billes de verre, afin de déterminer si la compressibilité de l'air jouait un rôle dans le phénomène d'atténuation. En estimant l'ordre de grandeur de la taille des bulles à quelques centaines de microns, nous avons placé des billes de 200 µm dans de l'eau et nous avons appliqué notre protocole expérimental à ce liquide (sans l'agitation de la bouteille), lors de la phase de sédimentation des billes (voir figure 11).
|
Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
La figure 11 montre bien que la présence de billes qui sédimentent ne modifie pas la fréquence de résonance du système car ces dernières sont beaucoup moins compressibles que les bulles d'air. Cela montre que la compressibilité de l'air joue un rôle dans le décalage fréquentiel et dans l'atténuation et que les bulles n'interviennent pas uniquement comme un objet diffusant.
Par la suite, qualitativement, nous avons essayé de voir si le temps caractéristique d'atténuation utilisé en partie 1 est corrélé au temps caractéristique de présence des bulles dans le liquide. Nous reprenons alors le même protocole avec agitation de la bouteille.
Pour ce faire, nous avons utilisé la loi de Beer-Lambert pour déterminer l'évolution de la concentration en bulles dans le liquide (ici un mélange eau-glycérol) : nous avons filmé la bouteille en plaçant un panneau LED à l'arrière (figure 12) et nous avons calculé l'intensité moyenne qui passe à travers la bouteille en fonction du temps (figure 13). La transmission de la lumière à travers le liquide bulleux est montré sur la figure 12 à trois instants différents. Comme le prévoit la loi de Beer-Lambert, plus la concentration en bulle est élevée (temps court), plus la transmission de la lumière est faible.
|
Figure 12. Photos du liquide bulleux à 3 instants différents après agitation et début des chocs Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
|
Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Le graphe d'absorbance mis en vis-à-vis de la fréquence la plus basse du signal sonore, présenté sur la figure 13, montre qualitativement que la modification de fréquence de résonance est présente au même moment que les bulles (attention les deux échelles de temps sont légèrement différentes).
De plus, la présence de bulles modifie le facteur d'atténuation (\( \alpha \)) de l'onde de surpression sonore dans le liquide : \( p(x,t) = A e^{-\alpha x} e^{i(\omega t - kx)} \), comme montré dans la figure 14.
|
Figure 14. Graphe tracé à l'aide des formules données dans la thèse de Valentin Leroy [2] La fréquence choisie est : f = 5 000 Hz Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Ce facteur d'atténuation \( \alpha \) dépend de la concentration en bulles, ce qui explique la modification de l'atténuation en énergie/intensité sonore au cours du temps.
5. Comment augmenter l'intensité et la durée du phénomène observé ?
Le phénomène étant causé par les bulles d'air, nous pouvons essayer de faire varier différents paramètres qui influent sur la durée de vie des bulles : viscosité, masse volumique ou encore tension superficielle.
Nous avons donc étudié l'effet de la viscosité sur la fréquence des sons émis et sur le temps caractéristique pour différents liquides. Pour ce faire, nous avons réalisé différents mélanges eau-glycérol en faisant varier les proportions. Nos résultats expérimentaux sont présentés sur la figure 15 ; les valeurs de viscosité données en légende sont des valeurs tabulées.
|
Figure 15. Analyse temporelle de la fréquence du fondamental pour différents mélanges eau-glycérol Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
On voit que la fréquence principale évolue différemment selon la viscosité du liquide. L'augmentation de la viscosité du liquide se traduit par une augmentation de l'écart entre la fréquence initiale (beaucoup de bulles) et la fréquence finale (pas de bulles).
Une analyse plus poussée, présentée sur la figure 16, montre l'évolution du temps caractéristique d'atténuation \( (\tau) \) et la variation de fréquence \( (\beta = \frac{\Delta f}{f_0}) \), en fonction de la viscosité dynamique du mélange.
|
Source : Robin Geiller et Ganesh Tangavélou |
Le graphe de gauche de la figure 16 semble bien montrer que la durée d'atténuation augmente avec la viscosité du mélange, ce qui semble cohérent avec l'intuition : un liquide plus visqueux verra une bulle remonter à la surface avec une durée plus élevée. Cependant, la taille des barres d'erreur et le faible nombre de mesures ne permet pas de trouver une loi de dépendance plus explicite. Par ailleurs, par manque de temps, une étude similaire sur l'effet de la tension superficielle du liquide n'a pas pu être menée.
Conclusion
Pour conclure, l'intensité et la durée du phénomène d'atténuation observé rendent compte des propriétés physiques du liquide à l'intérieur de la bouteille. Ces propriétés physiques sont elles-mêmes dépendantes de la composition du liquide (présence de molécules aromatiques par exemple), et utilisées pour comparer la qualité de deux bouteilles d'alcools selon le son que l'on entend (avec modération bien sûr). Il faudrait cependant pousser l'étude chimique, en étudiant la viscosité en fonction de la concentration en arômes par exemple, pour effectuer des mesures autres que par comparaison !
Références
[1] International 16th physicists' tournament website.
[2] Acoustique des bulles : du milieu bulleux à la mousse liquide, Thèse présentée par Valentin Leroy, Université Paris-Diderot, 2016.
Pour citer cet article :
L'acoustique au service des distilleries d'alcool, Robin Geiller, Ganesh Tangavélou, novembre 2025. CultureSciences Physique - ISSN 2554-876X, https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Son-Alcool-IPT.xml


















![Graphe tracé à l'aide des formules données dans la thèse de Valentin Leroy [2]](https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/images/articles/alcohol-sound-check-ipt/attenuation.png)